Alain Robbe-Grillet : Temps et description dans le récit d'aujourd'hui
Marcel ayant l'esprit de contradiction, c'est au moment où l'on quitte (enfin !) le réalisme qu'il se passionne pour la description. Voici donc un large extrait des spéculations d'Alain Robbe-Grillet (Pour un nouveau roman, 1963) sur cet art particulier. Que ce soit le « panorama autour de la tête » ou le « panorama dans la tête » comme le dit cet excellent Henri Michaux, décrire est un art multiple qui répond selon les auteurs et les époques, à des besoins différents. Le Merveilleux au programme cette année, couplé avec la représentation littéraire nous invite à réfléchir sur ce que décrire veut dire.
TEMPS ET DESCRIPTION DANS LE RÉCIT D'AUJOURD'HUI
[...]On a souvent remarqué, et à juste titre, la grande place tenue par les descriptions dans ce qu'il est convenu d'appeler Nouveau Roman, en particulier dans mes propres livres. Bien que ces descriptions objets immobiles ou fragments de scène – aient en général agi sur les lecteurs de façon satisfaisante, le jugement que beaucoup de spécialistes portent sur elles reste péjoratif ; on les trouve inutiles et confuses; inutiles, parce que sans rapport réel avec l'action, confuses parce que ne remplissant pas ce que devrait être, censément, leur rôle fondamental : faire voir.On a même dit, en se référant aux intentions sup- posées des auteurs, que ces romans contemporains n'étaient que des films avortés et que la caméra devrait ici relayer l'écriture défaillante. D'une part, l'image cinématographique montrerait du premier coup, en quelques secondes de projection, ce que la littérature s'efforce en vain de représenter au long de dizaines de pages; d'autre part, les détails superflus se trouveraient par force remis à leur place, le pépin de pomme sur le plancher ne risquant plus d'envahir tout le décor où la scène se déroule.Et tout cela serait vrai, si l'on ne méconnaissait pas ainsi ce qui risque justement de constituer le sens de ces descriptions pratiquées aujourd'hui dans le roman. Une fois de plus, il semble que ce soit bien par référence au passé que l'on juge (et condamne) les recherches actuelles.Reconnaissons d'abord que la description n'est pas une invention moderne. Le grand roman français du XIX siècle en particulier, Balzac en tête, regorge de maisons, de mobiliers, de costumes, longuement, minutieusement décrits, sans compter les visages, les corps, etc. Et il est certain que ces descriptions-là ont pour but de faire voir et qu'elles y réussissent. Il s'agissait alors le plus souvent de planter un décor, de définir le cadre de l'action, de présenter l'appa- rence physique de ses protagonistes. Le poids des choses ainsi posées de façon précise constituait un univers stable et sûr, auquel on pouvait ensuite se référer, et qui garantissait par sa ressemblance avec le monde « réel »l'authenticité des événements, des paroles, des gestes que le romancier y ferait survenir. L'assurance tranquille avec laquelle s'imposaient la disposition des lieux, la décoration des intérieurs, la forme des habits, comme aussi les signes sociaux ou caractériels contenus dans chaque élément et par les- quels celui-ci justifiait sa présence, enfin le foisonne- ment de ces détails justes auquel il semblait que l'on puisse indéfiniment puiser, tout cela ne pouvait que convaincre de l'existence objective - hors de la littérature - d'un monde que le romancier paraissait seulement reproduire, copier, transmettre, comme si l'on avait affaire à une chronique, à une biographie, à un quelconque document. Ce monde romanesque vivait bien de la même vie que son modèle: on y suivait même à la trace l'écoulement des années. Non seulement d'un chapitre à l'autre, mais souvent dès la première rencontre, il était aisé de reconnaître sur le plus modeste objet domestique, sur le moindre trait du visage, la patine apportée par l'usage, l'usure laissée par le temps.Ainsi ce décor était-il déjà l'image de l'homme : chacun des murs ou des meubles de la maison repré- sentait un double du personnage qui l'habitait – riche ou pauvre, sévère ou glorieux - et se trouvait de sur- croît soumis au même destin, à la même fatalité. Le lecteur trop pressé de connaître l'histoire pouvait même se croire autorisé à sauter les descriptions : il ne s'agissait que d'un cadre, qui se trouvait d'ailleurs avoir un sens identique à celui du tableau qu'il allait contenir.Évidemment, lorsque ce même lecteur passe les descriptions, dans nos livres, il risque fort de se retrouver, ayant tourné toutes les pages l'une après l'autre d'un index rapide, à la fin du volume dont le contenu lui aurait entièrement échappé ; croyant avoir eu affaire jusqu'alors au seul cadre, il en serait encore à chercher le tableau.C'est que la place et le rôle de la description ont changé du tout au tout. Tandis que les préoccupa- tions d'ordre descriptif envahissaient tout le roman, elles perdaient en même temps leur sens traditionnel. Il n'est plus question pour elles de définitions préli- minaires. La description servait à situer les grandes lignes d'un décor, puis à en éclairer quelques éléments parle plus que particulièrement révélateurs; elle ne parle plus d'objets insignifiants, ou qu'elle s'attache à rendre tels. Elle prétendait reproduire une réalité préexistante ; elle affirme à présent sa fonction créatrice. Enfin, elle faisait voir les choses et voilà qu'elle semble maintenant les détruire, comme si son acharnement à en discourir ne visait qu'à en brouiller les lignes, à les rendre incompréhensibles, à les faire disparaître totalement. totalementIl n'est pas rare en effet, dans ces romans modernes, de rencontrer une description qui ne part de rien; elle ne donne pas d'abord une vue d'ensemble, elle paraît naître d'un menu fragment sans importance ce qui ressemble le plus à un point - à partir duquel elle invente des lignes, des plans, une architecture; et on a d'autant plus l'impression qu'elle les invente que soudain elle se contredit, se répète, se reprend, bifurque, etc. Pourtant, on commence à entrevoir quelque chose, et l'on croit que ce quelque chose va se pré- ciser. Mais les lignes du dessin s'accumulent, se sur- chargent, se nient, se déplacent, si bien que l'image est mise en doute à mesure qu'elle se construit. Quelques paragraphes encore et, lorsque la description prend fin, on s'aperçoit qu'elle n'a rien laissé debout derrière elle elle s'est accomplie dans un double mouvement de création et de gommage, que l'on retrouve d'ailleurs dans le livre à tous les niveaux et en particulier dans sa structure globale – d'où vient la déception inhérente aux œuvres d'aujourd'hui.Le souci de précision qui confine parfois au délire (ces notions si peu visuelles de « droite » et de « gauche », ces comptages, ces mensurations, ces repères géométriques) ne parvient pas à empêcher le monde d'être mouvant jusque dans ses aspects les plus maté- riels, et même au sein de son apparente immobilité.Il ne s'agit plus ici de temps qui coule, puisque paradoxalement les gestes ne sont au contraire donnés que figés dans l'instant. C'est la matière elle-même qui est à la fois solide et instable, à la fois présente et rêvée, étrangère à l'homme et sans cesse en train de s'inventer dans l'esprit de l'homme. Tout l'intérêt des pages descriptives - c'est-à-dire la place de l'homme dans ces pages – n'est donc plus dans la chose décrite, mais dans le mouvement même de la description.On voit dès lors combien il est faux de dire qu'une telle écriture tend vers la photographie ou vers l'image cinématographique. L'image, prise isolément, ne peut que faire voir, à l'instar de la description balzacienne, et semblerait donc faite au contraire pour remplacer celle-ci, ce dont le cinéma naturaliste ne se prive pas, du reste.L'attrait certain que la création cinématographique exerce sur beaucoup de nouveaux romanciers doit, lui, être cherché ailleurs. Ce n'est pas l'objectivité de la caméra qui les passionne, mais ses possibilités dans le domaine du subjectif, de l'imaginaire. Ils ne conçoivent pas le cinéma comme un moyen d'expression, mais de recherche, et ce qui retient le plus leur attention c'est, tout naturellement, ce qui échappait le plus aux pouvoirs de la littérature: c'est-à-dire non pas tant l'image que la bande sonore — le son des voix, les bruits, les ambiances, les musiques - et surtout la possibilité d'agir sur deux sens à la fois, l'œil et l'oreille: enfin, dans l'image comme dans le son, la possibilité de présenter avec toute l'apparence de l'objectivité la moins contestable ce qui n'est, aussi bien, que rêve ou souvenir, en un mot ce qui n'est qu'imagination.Il y a dans le son que le spectateur entend, dans l'image qu'il voit, une qualité primordiale : c'est là, c'est du présent. Les ruptures de montage, les répétitions de scène, les contradictions, les personnages tout à coup figés comme sur des photos d'amateur, donnent à ce présent perpétuel toute sa force, toute sa violence. Il ne s'agit plus alors de la nature des images, mais de leur composition, et c'est là seulement que le romancier peut retrouver, quoique transformées, certaines de ses préoccupations d'écriture.Ces structures filmiques nouvelles, ce mouvement des images et des sons, se révèlent directement sensibles au spectateur non prévenu ; il semble même que, pour beaucoup, leur pouvoir soit infiniment plus fort que celui de la littérature. Mais ils déclenchent aussi, au sein de la critique traditionnelle, des réac- tions de défense encore plus vives.J'ai pu en faire personnellement l'expérience lors de la sortie de mon second film (L'Immortelle). Bien entendu, il n'y a pas lieu de s'étonner des jugements défavorables portés sur lui par la plupart des feuille- tonnistes; mais il peut être intéressant de noter cer- tains de leurs reproches, plus révélateurs souvent que des éloges. Voici donc les points sur lesquels se sont portées les attaques les plus fréquentes et les plus violentes: d'abord le manque de « naturel » dans le jeu des acteurs, ensuite l'impossibilité de distinguer clairement ce qui est « réel » de ce qui est mental (souvenir ou phantasme), enfin la tendance des éléments à forte charge passionnelle à se transformer en « cartes-postales » (touristiques pour la ville d'Istanbul, érotiques pour l'héroïne, etc.).On voit que ces trois reproches n'en constituent au fond qu'un seul : la structure du film ne donne pas assez confiance dans la vérité objective des choses. Deux remarques, à ce sujet, s'imposent. D'une part, Istamboul est une vraie ville, et c'est bien elle que l'on voit d'un bout à l'autre de la projection; de même l'héroïne est incarnée à l'écran par une vraie femme. D'autre part, pour ce qui est de l'histoire, il est évident qu'elle est fausse : ni l'acteur ni l'actrice ne sont morts au cours du tournage, ni même le chien. Ce qui déroute les spectateurs épris de « réalisme », c'est que l'on n'essaie plus ici de leur faire croire à rien – je dirais presque : au contraire... Le vrai, le faux et le faire-croire sont devenus plus ou moins le sujet de toute œuvre moderne ; celle-ci, au lieu d'être un prétendu morceau de réalité, se développe en tant que réflexion sur la réalité (ou sur le peu de réalité, comme on voudra). Elle ne cherche plus à cacher son caractère nécessairement mensonger, en se présentant comme une « histoire vécue ». Si bien que nous retrouvons là, dans l'écriture cinématographique une fonction voisine de celle assumée par la description en littérature : l'image ainsi traitée (quant aux acteurs, au décor, au montage, dans ses rapports avec le son, etc.) empêche de croire en même temps qu'elle affirme, comme la description empêchait de voir ce qu'elle montrait.[...]
Alain Robbe-Grillet, « Temps et description dans le récit », Pour un nouveau roman, Éditions de Minuit, 1963, pp. 157-163

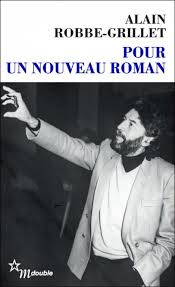




Commentaires
Enregistrer un commentaire